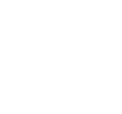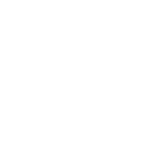Le recours à la stérilisation (vasectomie et ligatures des trompes) est en hausse (cf. France : les vasectomies ont dépassé les stérilisations féminines). Cette augmentation est également observée chez les jeunes [1] qui sont en parallèle incités à donner leurs gamètes (cf. Don de gamètes, contraception : les jeunes ne méritent-ils pas qu’on les prenne au sérieux ? ; L’ABM en campagne pour le don de gamètes)[2]. Christian Flavigny et Michèle Fontanon-Missenard, tous deux pédopsychiatres, psychanalystes et directeurs de recherche à l’Institut Thomas More, interrogent ce phénomène et livrent leur analyse pour Gènéthique.
« Faire » des enfants est-il passé de mode dans « la modernité » ? Une tendance s’affirme de renoncer à jamais à « en avoir », en se soumettant à une stérilisation précoce et irréversible, par ligature des trompes chez les jeunes femmes et vasectomie chez de jeunes hommes. Comment le comprendre ?
Le refus du maternel sacrificiel
Un argument invoqué est l’astreinte que la présence de l’enfant impose à la vie des adultes ; et nul doute que s’occuper de ses enfants dévore le temps, au détriment d’autres occupations possibles dans leur vie. La réaction des femmes décrites pas Eve Vaguerlant [3], embarrassées par le rôle maternel consacré à leur enfant qu’elles disent néanmoins aimer, traduit que ce temps consacré à l’épanouissement de leur enfant n’est pas source ressentie d’un épanouissement pour elles.
Prendraient-elles le contrepied du sort que subissaient les femmes de jadis, que l’on décrit confinées à la tâche éducative de leur progéniture, censées s’y être adonnées plus par devoir que par plaisir ? Les femmes d’aujourd’hui se détourneraient-elles de ce qui est tenu pour un dévouement sacrificiel qu’aurait enduré leurs aïeules, dans le but de préserver la vie professionnelle qu’elles revendiquent accomplie, d’autant que les mesures sociales ne suffiraient pas à concilier leur vie de travail avec une vie de famille ? Ne veulent-elles plus s’imposer une tâche éducative chronophage et épuisante ? Mais quel est le critère d’accomplissement d’une vie : seulement professionnel, amical, amoureux – mais pas familial ?
Certes si la tâche maternelle n’est perçue que comme une frustration, si elle n’épanouit pas leur vie de femmes devenant mères – comment alors ne pas comprendre ces femmes qui disent aujourd’hui « regretter » d’avoir eu des enfants ou qui prennent des mesures de contraception définitive ? Jugent-elles que l’épanouissement de la vie d’adultes, avec la réussite sociale en ligne de mire et les plaisirs qui vont avec la liberté individuelle, sans responsabilité contraignante, serait entravée par la tâche parentale ?
Le bonheur et le don
Ce qui se trouve éludé par cette préoccupation, c’est le bonheur ; le bonheur, contrairement au plaisir qui peut être individuel, est le fruit d’un partage, et plus encore : d’un don. Il ne s’agit pas du cadeau – encore que le cadeau n’ait de saveur que comme intention de donner ; il s’agit plus essentiellement du don fait à autrui de ce dont il est manquant : un don existentiel.
Le don est un partage, selon deux facettes fondant la relation : donner et recevoir. Le don n’opère que si le donneur reçoit en retour : le donneur donne au receveur ce qui lui est manquant, mais à condition de recevoir de lui ce qu’il donne, dont le donneur est manquant ; cela fonde le lien anthropologique, selon ses deux axes : entre les sexes et entre les générations.
Le don anime l’union d’un couple ; la femme donne à l’homme la féminité dont il est manquant. Mais c’est à condition d’accepter d’être manquante de la masculinité, et que l’homme en soit le dépositaire. Les modalités diffèrent : l’union sexuelle mêle le masculin comme don de puissance fait par l’homme à la femme, et le féminin comme puissance du don fait par la femme qui « se donne » à l’homme. La jouissance, corporelle dans l’orgasme, émotionnelle dans le bonheur, est la plénitude dans la rencontre des sexes qu’unit leur différence.
De la différence dans la modalité, masculine ou féminine, du don, il résulte une différence dans le vécu de cette union ; l’homme accède aisément au plaisir d’organe, il n’a pas besoin de l’amour. La femme accède plus aisément à la jouissance, ce dont Tirésias a témoigné, ce qui lui valut son châtiment car on ne révèle pas impunément les secrets du cœur féminin ; mais « une femme ne peut se donner pleinement sans amour [4] ». L’union sexuelle amoureuse conjoint le plaisir et la jouissance. Le bluff de la pornographie, c’est d’instiller l’idée que la femme serait en quête du seul plaisir, autrement dit d’un plaisir phallique.
Le don fonde aussi le lien générationnel ; être parent, c’est donner à son tour à son enfant ce dont on a jadis bénéficié en tant qu’enfant. Le don parental est une restitution de ce qui fut reçu jadis en tant qu’enfant et qui permit de vivre et de grandir – pour le meilleur ou parfois le moins bon, reviviscence qui fait revivre l’enfance au travers de son enfant, qui fait « se retrouver en lui », essence même du lien parental servant de guide intérieur établissant la protection de l’enfant. Cela inspire à l’enfant une dette qui devient l’axe soutenant son développement, dans son vœu d’honorer et d’être à la hauteur des attentes de ses parents, puis plus tard, devenu adulte, en devenant lui-même parent pour ses propres enfants, qui seront les petits-enfants de ses parents : c’est la Loi symbolique, nouant le don et la dette.
C’est la clé du bonheur. Donner à son enfant découle d’une restitution de la dette passée, engrangée comme enfant ; cela puise à ce qui fut reçu en tant qu’enfant, ce qui suppose de se sentir avoir reçu, avec un tri parfois douloureux à effectuer du bagage psychoaffectif dont on se sent l’héritier. Mais pour accéder au bonheur, le don doit fonctionner dans les deux sens : oui, il est beaucoup donné aux enfants – mais il est beaucoup reçu d’eux. Donner en retour de ce qui est reçu, la question agite tous les enfants, dans leur vœu que leur présence au monde, dont ils se savent redevables à leurs parents, procure à ces derniers une prime de bonheur ; s’ils ne la perçoivent pas, ils se sentent malheureux.
Affranchissement / accomplissement : l’enjeu du renoncement
Tout cela, c’est le sel de la vie ; ces repères ont été brouillés par une caricature résumant « la féminité » et « la masculinité », à des « stéréotypes », façon d’éluder l’essentiel : la condition sexuée confronte les êtres humains à leur incomplétude, et leur condition mortelle à leur finitude – ce vécu est au cœur de l’aventure humaine dans sa fragilité. Deux voies s’ouvrent : celle de l’affranchissement libérant des tâches pesantes de l’éducation et des tracas de la vie familiale ; et celle de l’accomplissement, dans le choix d’avoir des enfants, non par devoir, non par sacrifice, mais par option d’un bonheur à conquérir.
Toutefois, objection : la vie amoureuse, sans enfant, ne suffit-elle pas à garantir le bonheur ? Platon répondait : « c’est bien dans les propos inspirés de Diotime que l’on trouve la conception platonicienne de l’amour : l’amour est bien plus que la tension de deux êtres l’un vers l’autre : il n’engage pas seulement deux termes dont la fusion serait la finalité idéale et l’aboutissement réussi, il en engendre un troisième : un “rejeton”, une pensée, une œuvre [5] » ; en cela la procréation est un accomplissement. Mais la partition sexuée impose un renoncement : s’approprier la facette de l’humain correspondant au donné corporel, ainsi le masculin pour le garçon qui vaut renoncement au féminin (et vice-versa pour la fille) ; processus psychique dont le « sentiment transgenre » témoigne la part d’épreuve [6].
La voie de l’affranchissement (ne pas avoir d’enfants) est le leurre d’une libération, analogue à celle que plaida la « libération des enfants », les émancipant d’une manière factice au prétexte de les soulager de la tutelle parentale jugée oppressante, aboutissant à les priver du bénéfice du lien à leurs parents [7]. Se priver à jamais d’avoir des enfants, apparaît comme la même illusion, en symétrie : priver l’enfant d’avoir ses parents, se priver d’avoir ses enfants, c’est jeter le bébé avec l’eau du bain, c’est le cas de le dire.
La narcissisation, œuvre familiale
De la tâche parentale découle la lourde charge de l’éducation : les enfants grandissent de l’attention coûteuse en temps qui leur est portée, sans quoi ils dépérissent. Mais par-delà les tracas du rôle, être parent métamorphose la vie d’adulte par la joie de voir naître puis grandir ses enfants à leur personnalité, ce qui suppose de leur transmettre les ingrédients pour grandir : cette transmission est le don fait à l’enfant par son parent, don d’avoir été lui-même enfant dans le passé – la seule recette pour gérer la tâche. Donner en tant que parent est une mutation de la vie qui accompagne la découverte de celle-ci par son enfant.
Du lien familial découle une gratification intense, par-delà les tracas de l’éducation, gratification qui diffuse des parents aux enfants et des enfants aux parents : une fierté partagée. Bien des adultes souffrent, qui ne parviennent à avoir des enfants, disant ne pas parvenir à « se réaliser ». La relation des parents à leurs enfants (puis leurs petits-enfants, etc.) est l’antidote à l’écoulement de la vie ; elle soulage les adultes du temps qui passe : les parents vivent de la vitalité enfantine puis juvénile de leur progéniture, ils vivent à l’heure de leur(s) enfant(s), puis les grands-parents à celle de leurs petits-enfants.
L’option radicale de la stérilisation
Quelles sont les questions que se posent les jeunes adultes pensant mieux épanouir leurs vies en se détournant à jamais du bonheur d’avoir des enfants ? Que reflète la radicalité qui fait chez des sujets encore jeunes, non pas différer le moment d’avoir des enfants par le recours à la contraception, mais à jamais en éradiquer tout projet ?
La question féminine questionne la compatibilité entre une vie professionnelle accomplie, à laquelle beaucoup aspirent, et la tâche de mère auprès de ses enfants. L’exemple des carrières médicales montre pourtant qu’un équilibre peut être géré : en un demi-siècle, les femmes sont devenues majoritaires en pratique médicale, d’où il est résulté une diminution globale du temps consacré à l’exercice professionnel (d’ailleurs mal anticipée par les pouvoirs publics), les femmes tenant à conserver du temps pour jouer leur rôle de mère. Cet aménagement du temps – sans doute pénalisant au strict plan de l’activité professionnelle, profite à l’épanouissement des enfants
Mais cela contrevient au dogme féministe qui aligne l’épanouissement des femmes sur un modèle masculin : « l’égalité des salaires », etc. Or discuter ce dogme n’est pas prétendre « reconfiner » les femmes au foyer domestique ; c’est interroger un équilibre qui tienne compte d’un vœu féminin d’une vie professionnelle se conciliant avec une présence effective dans la vie familiale, différente de celle des hommes et des pères. Deux intérêts se rejoignent, celui de la femme si elle s’épanouit comme mère et celui des enfants. Or la présence maternelle prime pour fonder la vie psychoaffective de l’enfance [8] ; l’amour maternel porte la confiance en soi de l’enfant, nouant la fusion mère-bébé puis mère-enfant qui soutient son éveil à lui-même. L’amour paternel est aussi fondateur, en un apport plus symbolique et moins charnel, écartant progressivement la fusion intime mère-enfant qui permettra plus tard à celui-ci de s’autonomiser.
La thèse féministe se base sur l’équivalence des adultes homme-femme, sans tenir compte des rôles contrastés père-mère, dans l’intérêt de l’enfant, mais aussi dans l’épanouissement de modalités différentes d’un bonheur parental, Il ne s’agit pas d’assujettir la femme aux tâches ménagères et familiales, mais qu’elle puisse préférer être à l’écoute de ses enfants rentrant de l’école et préparer leur goûter, plutôt qu’assister jusqu’à onze heures du soir aux réunions d’un conseil d’administration. Le caractère dogmatique du féminisme piège à cet égard le libre choix des femmes ; il n’est pas inconvenant d’estimer qu’elles sont plus naturellement sensibles au lien alimentaire dans sa portée relationnelle – il est des femmes soucieuses d’allaiter leur enfant, qui trouvent un intense plaisir à ce moment privilégié que jamais homme ne connaîtra.
Aspects psychologiques
Le refus de transmettre à l’enfant en tant que parent, peut-il provenir d’une difficulté à vivre la transmission depuis ses propres parents ? La question est en cela commune à l’homme et à la femme. Devenir mère s’appuie sur l’identification à sa propre mère : c’est relayer ce qu’elle fit jadis (idem pour la paternité, pour l’homme). Cette « prise de rôle » peut être embarrassée par une rancœur si la relation mère-fille a été malheureuse, avec un vœu de s’en démarquer. Le risque est que s’impose un « à quoi bon avoir des enfants ? » désabusé, dans la conviction que le bonheur n’est pas garanti, et que mieux vaut fuir le fait d’avoir des enfants comme un « devoir à accomplir », manière du passé attribuée à nos aïeules (non sans caricature), menant au dépit plaidant ne pas en avoir.
Car il est deux solutions à cet éprouvé : écarter le projet d’avoir des enfants est celle radicale ; mais elle prive du bonheur d’être mère (père), alors que la relation future à son propre enfant demeure le meilleur soulagement aux souffrances ressenties dans son propre passé. Démêler cet imbroglio souffrant est une solution alternative, certes astreignante en faisant resurgir des épreuves enfouies, mais aussi productive, allégeant leur poids et en libérant.
S’affranchir d’un destin ?
La décision irrévocable d’une stérilisation précoce, serait-ce s’affranchir de ce qui aurait été jadis un destin procréatif imposé aux femmes : fille → femme → mère [9] ? La première flèche est déjà subvertie par le « transgenrisme » qui a « libéré » de l’« assignation corporelle » ; le principe est devenu : fille → femme ou homme, selon le ressenti. L’affranchissement de la seconde : femme → mère est désormais engagé par une décision de la justice française de reconnaître comme « mère » de son enfant son géniteur [10] : homme → femme → mère (cf. Né homme, la justice ordonne qu’il soit déclaré “mère” de son enfant). S’agit-il d’aller plus loin dans « l’affranchissement », en abolissant la mission jugée avoir été imposée aux femmes par le patriarcat dominateur, d’avoir des enfants : femme → mère.
Notre époque fonde ses valeurs dans la dénonciation de celles décrétées avoir emprisonné les destins. Elle omet que la maternité a pu être un rôle consenti par les femmes, qui l’assumaient dans la fierté du rôle insigne d’engendrer l’humanité, jusqu’à surmonter l’épreuve de la grossesse, même sachant qu’elle pouvait conduire à leur possible mort en couches, risque effectif d’hémorragies tant que les techniques médicales n’eurent pas permis les transfusions sanguines [11]. On peut y voir une dévotion sacrificielle – c’est la manière de notre époque de dénigrer le passé, façon d’éluder la dette que nous avons à l’égard de nos aïeules.
Les femmes d’aujourd’hui ont-elles éradiqué la maternité de leur destin ? La liberté acquise dans leur vie par la contraception n’y suffisait donc pas ? (cf. Contraception : une réaction plus négative au stress) On assiste à un « moment hystérique » au sens étymologique du terme : l’interruption de grossesse, « constitutionnalisée » comme un droit irréfragable des femmes à l’avortement, venge-t-elle la condamnation comme infanticides de celles qui recoururent à l’avortement [12] ? (cf. IVG dans la Constitution : « l’enjeu est celui de la liberté des citoyens, et pas seulement de la femme »)
La stérilisation définitive et précoce concerne désormais de jeunes hommes réclamant la vasectomie, se garantissant ainsi d’à jamais ne pas devenir pères. Est-ce de leur part une soumission au phénomène hollywoodien #metoo, offrant leur stérilisation pour prendre leur part de l’astreinte contraceptive qui revenait aux femmes (pilule, stérilet) ? La violence sur soi perpétrée de cette privation paternelle résonne comme une castration ; s’agit-il d’une forme ultime de castration symbolique dans un vœu masculin de ne pas paraître menaçant pour la femme, à l’heure où le désir masculin, ou plutôt « mâle », est dénoncé comme encombrant pour la vie des femmes – en tout cas de certaines femmes ? Notre époque entretient une réputation peu flatteuse de la paternité, insistant sur les violences masculines, qui existent sans qu’il soit justifié d’en faire une généralité, validant dans les lois qu’une femme seule ou deux femmes en union de même sexe puissent recourir aux techniques de Fécondation Médicalement Assistée ; cela mène-t-il à y renoncer ?
Le plaisir plutôt que le bonheur
Aujourd’hui, « le bonheur et le don » sont des notions discréditées ; notre époque valorise « le plaisir » et taxe le don d’être valeur traditionnaliste voire religieuse, chargée de connotation sacrificielle contredisant les « valeurs » de notre époque prônant la satisfaction individuelle. Le regard actuel sur la vie sexuelle est dominé par l’idéologie du plaisir corporel, dans une conception hédoniste, horizon avoué de notre époque qui pense jouer son rôle en initiant les enfants à la découverte de la masturbation (précisons bien : les enfants), selon des programmes éducatifs préconisés par l’Union européenne et par l’Education nationale [13], en violation du rôle protecteur de l’énigme dans la maturation de l’enfant ; de façon illustrative, ce regard vante l’homosexualité comme goûtant mieux aux plaisirs de la chair [14], promotion basée sur le plaisir charnel, omettant que ce qui anime la relation homme-femme, c’est de le vivre dans l’incomplétude des sexes avec sa part de l’inconnu de l’autre sexe.
Retournement des générations
La dénatalité propre aux sociétés occidentales suspend le renouvellement des générations ; cela doit-il au fait que notre époque a suspendu voire aboli le principe même de leur succession, à la raison qui ne manque pas d’être hypocrite d’une égalité des droits censée respecter les plus jeunes ? La relation parent-enfant devient régie comme si elle était une relation d’adulte à enfant, sans autre spécificité : la transmission psychique, pourtant principe régulateur spécifique à cette relation, est ignorée au prétexte de protéger l’enfant de ses nuisances possibles. Dissipant le lien psychique de transmission, le lien familial n’est plus régi comme le nouement symbolique du don parental et de la dette enfantine résultante, qui scelle la filiation dans sa charge psychoaffective ; elle devient une relation juridique de droits, selon l’inspiration de la logique nord-américaine. L’enfant est traité en « petit adulte en miniature », au prétexte de ne pas le « discriminer selon l’âge » afin de le respecter (cf. « Les jeunes », faux héros et vraies proies de notre époque).
Cette logique déstabilise l’équilibre de la famille, ravalant le rôle des parents à être « accompagnateurs » de leur enfant ; on le voit lors de la réclamation d’un jeune d’une transition médico-chirurgicale à la raison de se sentir « dans le mauvais corps » : les lois imposent que son seul point de vue prévale (cf. « Transition de genre » : le mineur apte à consentir ?). Tout cela altère-t-il l’envie d’avoir des enfants ? La notion-même de procréation s’est dissoute dans le progrès technique, résumée à sa seule facette biologique : la rencontre in vitro des gamètes mâle et femelle dans l’éprouvette ayant le même effet que l’alternative possible in utero par le rapport homme-femme – éradiquant le socle psychoaffectif où l’enfant fonde le sens de sa venue au monde.
La vague « occidentale » de dénatalité : l’argument « altruiste » de la protection de « la Planète »
Finalement, la dénatalité se pare d’une thèse écologiste plaidant soulager Dame Planète que menacerait une surpopulation : trop de poumons dégageant du CO2. L’argument touche alors les deux sexes, en une véritable ode entonnée en commun sur la protection de notre Terre-Mère, notre Ur-Mutter commune, telle la Gaia célébrée par les Grecs comme la Mère universelle – est-ce une dévotion à un Originaire maternel prenant la place du patriarcat honni et destitué ?
Quand de véritables questions qui se posent à l’humanité sont saisies dans des postures dogmatiques, prétendant se défaire de dogmes compassés …
[1] France Info, “Je n’ai pas envie de faire un gamin dans ce monde-là.” Le “boom” de la vasectomie chez les plus jeunes, Quentin Cezard (17/02/2024)
[2] L’ABM a à ce sujet financé plusieurs spots : Vous ne voulez pas faire d’enfants pour continuer vos meilleures parties ? ; Vous ne voulez pas faire d’enfants pour continuer les grasses matinées ? ; Vous ne voulez pas faire d’enfants pour continuer à profiter de vos soirées ?
[3] L’effacement des mères – Du féminisme à la haine de la maternité, L’Artilleur, 2024
[4] Jacqueline Schaeffer, Le féminin – un sexe autre, Éd In Press, 2023, p 74
[5] Geneviève Droz, Les mythes platoniciens, Seuil 1992, p 47
[6] Pour des raisons étudiées : voir Christian Flavigny, Comprendre le phénomène transgenre – la solution par la culture française, Ellipses, 2023
[7] Ainsi, dans fil du rousseauisme : Alain Renaut, La libération des enfants- Contribution philosophique à une histoire de l’enfance, Calmann-Lévy, 2002
[8] La répartition en temps équivalents entre père et mère dans le cas de garde alternée, au prétexte de la « parité », n’est pas favorable à la vie affective de l’enfant jeune.
[9] « Loin d’elle une vie comme celle de sa mère – confinée entre les murs d’un appartement bourgeois, une vie sans autre but que de faire des enfants … » Victoria Mas, Le bal des folles, Albin Michel, 2019
[10] Jugement de la Cour d’Appel de Toulouse, 9 février 2022
[11] Un sujet majeur de la vie féminine des siècles passés, qui n’intéresse pas les travaux des historiens plus captivés à dénoncer le supposé patriarcat, bref à infantiliser les femmes. Bien sûr il y a toujours de belles exceptions, en l’occurrence la si regrettée Anne Dufourmantelle : La femme et le sacrifice – D’Antigone à la femme d’à côté, Denoël, 2007. Noter en outre que Maurice Godelier (La mort et ses au-delàs, ouv. coll., CNRS, 2014) rapporte que les femmes mortes en couche étaient à l’époque antique inhumées avec les mêmes honneurs que les soldats morts à la guerre – ce drame, devenu heureusement très rare dans nos sociétés favorisées, était célébré comme un héroïsme.
[12] De même, la réclamation d’un congé pour règles douloureuses (“congé menstruel”, 4 avril 2024) exhibe-t-il ce qu’endure la nature féminine, en contrepied de la vexation qui jadis valait une relégation des femmes en règles au nom de leur « impureté » ?
[13] La page https://www.education.gouv.fr/le-conseil-superieur-des-programmes-41570 a été supprimée. Voir les alertes émises à l’initiative du Pr Maurice Berger : « “droits sexuels” et “éducation à la sexualité” : histoire d’une imposture » ; et la pétition que j’ai co-signée : « Stop à la dangereuse imposture des “droits sexuels” et de l’“éducation à la sexualité” » (2017). La question demeure entière. On devrait plutôt en la matière s’inspirer de « Sur les explications sexuelles données aux enfants », S. Freud, 1907, OCP VIII, p 147 sq
[14] Maïa Mazaurette « Comment peut-on encore être hétérosexuel ? » Le Monde (04/06/2022)
Photo : Hieu Van de Pixabay